
Angélique Delange, chocolatière émérite mais excessivement timide, postule dans une chocolaterie lyonnaise au bord de la faillite. Elle est alors embauchée par Jean-René Van Den Hugde, passionné mais terriblement mal à l’aise avec les femmes.
Avant le film, il y a d’abord un titre.
« Les Emotifs Anonymes » a quelque chose de curieux. D’accrocheur.
Puis il y a une affiche.
Entre style rétro, lumière blafarde et airs espiègles, une atmosphère se crée.
Jean-Pierre Améris, dont le nom n’évoque pas forcément grand-chose, signe une comédie romantique simple mais efficace, saupoudrée d'une pincée d'humour.
Si le film fonctionne, c’est principalement parce qu’il est porté par ses acteurs. Car, il faut bien le dire, bien que relevée par quelques originalités, l’histoire n’est pas des plus étoffées. Cependant, ça marche et c’est même plutôt agréable.
Isabelle Carré, qui semble faite pour donner vie à des personnages de femmes fragiles, incarne brillamment cette ingénue hyperémotive, qui ne supporte pas que son talent attire les regards. Intimidée par les autres, elle vit dans sa coquille depuis des années. Grâce à un quiproquo, elle réussira à faire un premier pas en dehors de sa bulle.
Elle est épaulée par Benoit Poelvoorde, qu’il est bon de voir jouer autrement qu’en sortant la grosse artillerie. Plutôt dans la finesse, il est juste dans l'interprétation de ce patron solitaire et timide.
Le décor et les costumes délicieusement surannés ajoutent du charme à cet univers chocolaté et collent parfaitement avec la candeur des personnages.
L’atelier de la chocolaterie, par exemple, est d’une grande beauté. Ce bâtiment de briques rouges, dont on soupçonne l’intérieur d’être resté intact depuis plus de cent ans, offre une ambiance un peu intemporelle, à l’image d’Angélique et Jean-René qui n’ont pas su se fondre dans le moule de leur époque.
Jean-Pierre Améris inscrit dans sa réalisation une atmosphère intimiste (plans serrés, lieux exigus…) rappelant justement le cocon dans lequel évoluent les personnages principaux.
Enfin, les touches d'humour distillées avec parcimonie donnent un rythme agréable au film.
Alors évidement, à première vue, la timidité de notre héroïne et l'aspect rétro du film ne sont pas sans rappeler, d’une certaine manière, Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain. Mais d’une certaine manière seulement…
Le film, qui offre un scénario original et une mise en scène soignée, est réussi. Cependant il compte aussi quelques petites déceptions.
Tout d'abord, la fin, amenée de manière légèrement abrupte, aurait sans doute pu être un poil moins conventionnelle.
Et enfin, hormis au générique de fin, pas une fois il n'est fait mention de la ville dans laquelle se situe l'histoire. Lyon, seulement reconnue au détour d’une impasse, aurait mérité quelques prises de vue qui auraient, par la même occasion, permis d'installer davantage l’histoire. Quitte à tourner en Province, pourquoi le cacher ?
En guise de prologue, un clip inédit de "Big Jet Plane" d'Angus and Julia Stone, qui signent donc le générique de fin du film, a été tourné. Pour l'occasion, Isabelle Carré et Benoit Poelvoorde endossent à nouveau brièvement leur rôle aux côté des deux Australiens.
Si l'idée de départ est sympathique, il est dommage de ne pas retrouver la patte d'Améris à la réalisation.
(Le clip : http://www.youtube.com/watch?v=jdHJEBaERCU )


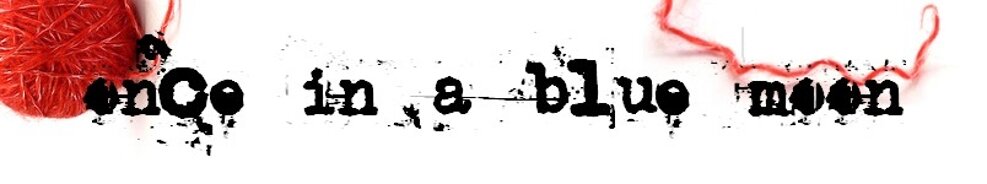























 Tout comme Hong Sang-Soo et Kim Jee-Woon, les deux réalisateurs mis à l’honneur durant le festival de Deauville, Park Chan-Wook est un autre grand nom du cinéma coréen.
Tout comme Hong Sang-Soo et Kim Jee-Woon, les deux réalisateurs mis à l’honneur durant le festival de Deauville, Park Chan-Wook est un autre grand nom du cinéma coréen.


 Si "blast" en anglais est le souffle provoqué par une explosion, "wind" fait sans doute écho au vide qu'il laisse dans la tête du spectateur. Car Wind Blast ne manque pas d'explosion, mais il manque cruellement de scénario !
Si "blast" en anglais est le souffle provoqué par une explosion, "wind" fait sans doute écho au vide qu'il laisse dans la tête du spectateur. Car Wind Blast ne manque pas d'explosion, mais il manque cruellement de scénario !



